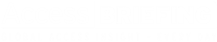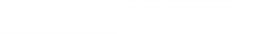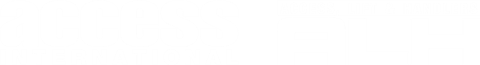Traduit automatiquement par IA, lire l'original
La construction des échafaudages a-t-elle changé depuis les années 1700 ?
16 décembre 2024
Comment un échafaudage parvient-il à tenir debout sans s'effondrer sous son propre poids ou sous les charges qui lui sont appliquées ? Si vous n'avez jamais vécu l'expérience exaltante d'être sur un échafaudage à plusieurs centaines de mètres du sol, avec un pied d'échafaudage de moins de cinq centimètres de diamètre, ajoutez-le à votre liste de choses à faire.
 Les charges des échafaudages suspendus n'appliquent pas de charge de compression axiale, mais une charge de flexion à l'extrémité extérieure de la poutre en porte-à-faux. (Photo : David Glabe)
Les charges des échafaudages suspendus n'appliquent pas de charge de compression axiale, mais une charge de flexion à l'extrémité extérieure de la poutre en porte-à-faux. (Photo : David Glabe)C'est magique de pouvoir supporter n'importe quelle charge. Pourquoi un échafaudage suspendu reste-t-il suspendu sans tomber ? Quel est le secret de la capacité de ces structures temporaires à supporter des charges importantes sur des pieds aussi fins et des fils aussi fins ? Si cela reste un mystère pour certains, et peut-être un miracle pour d'autres, il existe une explication.
L'idée de pouvoir calculer la résistance des matériaux était inconnue pendant des millénaires. La construction relevait davantage de l'art que de la science. Les artisans qualifiés exerçaient leur métier en s'appuyant sur l'expérience pour guider leurs travaux futurs. Les grandes cathédrales d'Europe illustrent cette méthodologie : les ouvriers repoussaient sans cesse les limites du savoir en construisant toujours plus grand, ne s'arrêtant que lorsqu'il était évident que la structure ne pouvait plus supporter les charges appliquées.
Supporter des charges
Ce n'est qu'au XVIIIe siècle que les sciences et les mathématiques se sont développées au point de permettre l'analyse précise, puis la détermination, de la capacité de matériaux spécifiques à résister aux forces et à supporter des charges. On a découvert à cette époque qu'il était possible de créer des formules permettant à un concepteur de déterminer non seulement la résistance d'un matériau, comme le fer, mais aussi la taille nécessaire à un composant structurel pour supporter une charge. Ces connaissances ont donné naissance à ce que l'on appelle l'ingénierie, et les praticiens de l'ingénierie les utilisent pour la conception et l'analyse. En fait, ces connaissances servent à démontrer comment et pourquoi un échafaudage peut fonctionner comme il le fait.
Une colonne, comme un pied d'échafaudage, peut supporter une charge de compression en fonction de trois facteurs : le type de matériau, sa forme et sa longueur non contreventée. Pour les échafaudages à cadre et les systèmes, un tube rond est la forme de choix. Un tube rond est utilisé car il offre une résistance égale dans toutes les directions, contrairement à un tube rectangulaire, par exemple, qui est plus résistant dans deux directions et plus faible dans les deux autres. Les tubes carrés, qui minimisent la différence, constituent le deuxième choix ; c'est pourquoi certains échafaudages sont équipés de tubes carrés. Pourquoi utiliser un tube plutôt qu'une tige pleine ? Après tout, un arbre est solide.
Des recherches ont montré que pour obtenir une meilleure résistance des tubes, il fallait beaucoup plus de matériau sur leur pourtour qu'au centre. Comme le matériau central n'était pas nécessaire, il a été retiré. C'est pourquoi on utilise des tubes plutôt que des tiges pleines. Certes, une tige pleine supportera une charge plus importante, mais l'économie prime, car les tubes produiront des résultats satisfaisants. D'ailleurs, imaginez le poids d'un échafaudage dont les pieds seraient des tiges pleines !
 Certains diront que les origines de la construction, notamment en ce qui concerne les structures et les principes de portance, relevaient davantage de l'art que de la science. (Photo : David Glabe)
Certains diront que les origines de la construction, notamment en ce qui concerne les structures et les principes de portance, relevaient davantage de l'art que de la science. (Photo : David Glabe)Formes changeantes
L'acier est le matériau de choix pour la plupart des échafaudages. Dès les débuts de l'ingénierie, il a été établi que la résistance d'un matériau variait considérablement en fonction de son mélange, notamment du rapport carbone/minerai de fer. Il a également été établi que les impuretés étaient néfastes. Pour garantir une régularité optimale, la production d'acier actuelle est rigoureusement contrôlée afin que la résistance du matériau soit parfaitement prévisible et que le fabricant d'échafaudages puisse ainsi produire un produit fiable. Bien sûr, un fabricant peu scrupuleux peut également utiliser un acier de qualité inférieure, mais nous y reviendrons plus tard.
Le troisième facteur déterminant la résistance à la compression d'une colonne est sa longueur non contreventée. Un tube non contreventé de 5 cm de diamètre est très résistant à la compression, mais à 6 mètres de hauteur, sa capacité est nulle. Leonhard Euler, mathématicien et physicien suisse du XVIIIe siècle, fut le premier à déterminer, outre le type de matériau et la forme de la colonne, que sa longueur non contreventée était un facteur important de sa résistance. Il développa ensuite une formule intégrant ces trois facteurs. Autrement dit, sa formule pour les colonnes, et celles qui suivirent, intègrent la relation entre la forme, la résistance du matériau et la longueur non contreventée. Pour les échafaudages, la longueur non contreventée correspond à la distance verticale entre les éléments horizontaux et à la distance verticale entre les assemblages diagonaux des contreventements.
Les monteurs d'échafaudages ne peuvent pas modifier le matériau utilisé ni la forme du pied d'échafaudage, sauf, bien sûr, s'ils ont utilisé un tube plié ou courbé. L'utilisation d'un tube plié ou courbé nuit à la résistance de la colonne et explique pourquoi il est déconseillé d'utiliser des composants d'échafaudage endommagés. Ce que les monteurs d'échafaudages peuvent faire, et font fréquemment, est de modifier la longueur non contreventée du pied d'échafaudage. L'exemple le plus courant concerne les échafaudages à cadre, où les traverses avant ne sont jamais installées. Cette pratique fait passer la longueur non contreventée de 1,20 m (distance entre les montants des traverses) à 1,90 m (hauteur nominale d'un cadre traversant). Ce faisant, la capacité du pied d'échafaudage est réduite jusqu'à 50 %. À l'inverse, l'augmentation du nombre d'éléments horizontaux et des diagonales verticales correspondantes sur un échafaudage système, réduisant ainsi la longueur non contreventée, augmente considérablement la capacité du pied d'échafaudage. Malheureusement, peu de monteurs comprennent l’impact du contreventement sur la capacité.
 De nos jours, aucune structure importante n'est conçue ou construite sans recours à la science. (Photo : David Glabe)
De nos jours, aucune structure importante n'est conçue ou construite sans recours à la science. (Photo : David Glabe)Les échafaudages suspendus sont également concernés par les recherches de M. Euler, mais peut-être pas de la manière attendue. Les poteaux tendus ne sont pas influencés par la longueur non contreventée ; les câbles peuvent donc supporter des charges considérables par rapport à leur diamètre. Les trois facteurs d'Euler se distinguent par la poutre en porte-à-faux horizontale à laquelle est fixé le câble de suspension. Bien que la charge de l'échafaudage suspendu n'exerce pas de charge de compression axiale, elle exerce une charge de flexion à l'extrémité extérieure de la poutre en porte-à-faux. Si la forme de la poutre est incorrecte, si la résistance du matériau est insuffisante ou si son contreventement est insuffisant, celle-ci se déformera, se tordra, se pliera et ne pourra finalement plus supporter la charge de l'échafaudage, ce qui aura des conséquences néfastes pour les occupants.
Le monde d'aujourd'hui
La conception et l'analyse des échafaudages sont issues de recherches initiées par des physiciens il y a trois siècles. Elles ont apporté une plus grande fiabilité dans la conception des structures et des échafaudages, et ont permis des économies de construction. Au fil du temps, elles ont mis fin à la pratique de construire des structures fondées sur l'expérience et les performances passées du constructeur.
De nos jours, aucune structure importante n'est conçue ou construite sans recourir à la science que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'ingénierie. À l'exception des échafaudages.
Étonnamment, l'industrie des échafaudages continue de construire des échafaudages comme en 1700, en s'appuyant sur des monteurs qui, ignorant la notion de longueur non contreventée, espèrent réussir en se basant uniquement sur l'expérience passée. Plus étonnant encore, cette pratique est considérée comme acceptable.
STAY CONNECTED



Receive the information you need when you need it through our world-leading magazines, newsletters and daily briefings.
CONTACTEZ L'ÉQUIPE